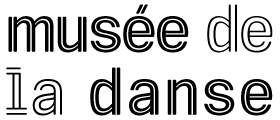« Ralentie, on tâte le pouls des choses », Henri Michaux, La ralentie.
Partant d'où ?
Soit un projet de centre chorégraphique d'un genre nouveau : le Musée de la danse. Soit un nouveau lieu pour l'accueillir, Le Garage. Et soit l'événement, le « happening », tissant ensemble lieu et projet, public, chorégraphes et danseurs – amateurs, professionnels, professeurs ou performeurs. C'était le samedi 27 avril 2009, de 19 heures à 7 heures du matin. Étrangler le temps : une nuit peuplée d'œuvres au ralenti, de mouvements suspendus se propageant dans les espaces du Garage. Une nuit feuilletée, où se sont superposés les propositions, les temporalités, les mémoires et les gestes. Une somme de moments dont s’est dégagé un continuum, un courant reliant de façon souterraine un concert, une performance butô, un cours de danse jazz, une ronde bretonne...
Si cette nuit ralentie a créé une expérience singulière – excédant la somme de ses moments – c'est sans doute qu'elle offrait la possibilité de repenser notre rapport au spectacle vivant, la manière dont nous le comprenons et le percevons. Et que pouvait se lire dans cette préfiguration la métaphore du rapport à l'institution, au public et à la création que tente d'inaugurer le Musée de Danse. Si la métaphore est un transport (comme nous le rappelle Claude Simon, Metaphoron est l'inscription qu'on peut lire sur les bus grecs), peut-être que l'objectif d'un « Musée de la Danse » serait de déplacer notre façon d'appréhender ce phénomène qu'on appelle la danse – de nous laisser le temps de voir, de comprendre, et de saisir d'où l'on regarde. Déplacer, pour rendre visible les circuits, les zones troubles, la porosité aux lieux, aux temps, aux paroles, aux formes artistiques ; pour tenter d'articuler le vivant et le réflexif – art et archive, création et transmission.
Le transport qui a eu lieu ce soir-là avait quelque chose d'un ralentissement général des fonctions. Un glissement de leurs frontières établies : déplacement de la fonction lieu culturel, de la fonction spectateur, de la fonction regard, des fonctions « genre », ou « famille » chorégraphiques.
Si les termes contradictoires musée et danse posent la question de la production et de la conservation, on peut se demander comment revenir sur cet événement, plusieurs mois après qu'il se soit déroulé. Quelle trace déposer, qui puisse faire trace pour d'autres – ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, qui y ont assisté ou qui n'en ont jamais entendu parler ? Et comment laisser émerger ces glissements (de temps autant que de terrain) qu'on ne peut saisir qu'au croisement – des espaces, des spectacles, des rumeurs, des expériences ? Faut-il s'emparer d'un souvenir ? D'un moment, d'un spectacle en particulier ? D'une ambiance ? D'un concept ? Des mots qui le désignent, des corps qui l'ont occupé, des photos ou des films qui le documentent ?
Chaque angle de vue que l'on choisisse en reflètera d'autres, chaque fil tiré peut dérouler plusieurs bobines. Nœuds innombrables : l'idée d'un « musée de la danse », en contient déjà beaucoup. Voilà quelques entrées et sorties, allers et retours, pour laisser défiler les bobines.
Rentrées
En entrant dans le Garage, à 19h, muni d'un plan figurant la localisation des différents événements, on est d'abord désorienté – spatialement autant que subjectivement. Pas de centre, ni de sens de circulation. Pas de mode d'emploi. Est-ce que ça se visite (comme un musée), est-ce que ça s'arpente (comme un espace), est-ce que ça se regarde (comme au théâtre), est-ce que ça s'expérimente (comme un atelier), est-ce qu'on s'y perd (comme dans un labyrinthe), est-ce que ça se consomme (comme au supermarché) ?
À la manière de la « promenade architecturale » prônée par Le Corbusier (un lieu n'existe qu'arpenté, révélant ses angles et sa plastique en fonction de la déambulation que chacun y dessine) l'organisation du Garage offre la possibilité d'inventer son parcours, sa vitesse et sa manière d'aborder les œuvres. Cette nécessité de trouver sa propre boussole va générer dans l'espace – parallèlement aux danses qui s'y déroulent – une grande diversité d'attitudes et d'états. Certains spectateurs circulent vite, passant d'une salle à une autre. D'autres au contraire s'arrêtent, s'absorbent dans la contemplation d'un geste. En face de cet inhabituel décrescendo, les corps s'animent ou se figent, se pressent, s'attardent. Il faut trouver une manière de s'ajuster.
Le rapport à cette masse désorientée, lâchée dans un espace sans frontières établies a dû être assez violent pour les danseurs, transformés en décor, objets, ou mannequins : scrutés, bousculés, dérangés (ou ignorés), ils sont eux aussi privés de leurs repères. Aperçu : deux adolescentes se prennent en photo avec leurs téléphones portables, à côté d'un danseur presque immobile, comme si c'était un père noël de supermarché. Un peu comme ces gardes anglais qui n'ont pas le droit de bouger ou de réagir, les danseurs continuent, imperturbables. Le temps joue pour eux. Le ralenti insiste. Passé l'effet de frénésie de l'entrée des spectateurs, on remarque que quelque chose de la lenteur commence à passer dans les corps. Au milieu de ces silhouettes comme en apesanteur, l'impression d'être trop rapide, cassant, maladroit oblige à soi-même ralentir. Un effet de contamination se propage, un imperceptible changement d'état.
Il apparaît rapidement que le happening compte autant de participants que de personnes présentes. L'objet du regard n'est plus seulement ce qui danse, mais tout ce qui bouge : l'ensemble des réactions et des rapports devient partie prenante de l'événement.
Des places
Le Crash dance – que l'on pouvait découvrir au début de la soirée – se déroule dans un espace assez étroit. En entrant dans la pièce, on découvre des corps debout, d'autres penchés, assis, allongés. Certains regardent, d'autres sont regardés – mais sans qu'il soit vraiment possible de dire dans quel sens s'effectue la circulation, qui est acteur d'un geste, et qui est spectateur immobile. Une zone de brouillage se profile, un enchevêtrement des positions particulièrement sensible : l'instabilité des places.
En un sens, personne n'est à sa place, à chacun de l'inventer. Place physique (bancs, coussins, sièges) et place subjective (comment être spectateur, danseur), habituellement préparées, se retrouvent indiquées et mises en miroir : de la place, il ne cesse d'en manquer, ou d'en rester – pas de position d'équilibre. Dans une pièce sans places assises, on s'entasse comme on peut. Dans une autre, plus vaste, et tapissée de coussins, quelques spectateurs à peine ; certains regardent, d'autres se reposent ou écrivent. Dans un dispositif où les spectacles ne sont pas nécessairement étiquetés (on peut regarder, longtemps, une pièce, sans savoir de qui, ou de quoi il s'agit), de la place est laissée au désœuvrement. Une proposition, La fonte de l'individu, image parfaitement le montage de ces questions : dans un couloir, (et un peu plus tard, débordant jusque dans le hall), quiconque peut se laisser fondre « de la position verticale jusqu'à l'étalement le plus lourd ». Il suffit de se choisir une place, et de la défaire.
Pour qui découvre le spectacle de ces corps – à différentes étapes du dégel – il peut tout aussi bien s'agir d'une performance en cours que d'une invitation à faire de même, d'un danseur que d'un spectateur. Moment de relâchement, de vacance, à lire comme une image drôle ou funèbre. L'image d'une fin, ou du plus parfait désœuvrement.
Dédanser
L'artiste belge Eric Duyckaerts a inventé un jeu qui « consiste à partir du préfixe "dé" dans le système des verbes français. Ôter le "dé" (dédéser), ajouter le "dé" (déser), voir comment ça marche, inventer des sens et des mots » (Jacques Dubois). Délirer, par exemple, permet d'inventer le verbe « lirer », déchirer, « chirer » (on peut ensuite essayer de leur trouver un sens). On pourrait comparer cette méthode – qui introduit du jeu et du coup, de nouveaux usages dans la langue – avec les effets produits sur la danse par le ralenti. Des règles tombent, de nouveaux usages se révèlent.
Pour cette première prise de contact avec le public, un espace permet de faire soi-même l'expérience du ralenti de manière inattendue : un cours de danse jazz proposé par Wayne Barbaste, auquel chacun peut participer. Neutralisant la virtuosité (souvent liée à la vitesse d'exécution), le savoir-faire, le ralenti rend le fait d'entrer dans la danse possible, sans se sentir scruté, ou jugé, sans avoir besoin de savoir danser, ou de connaître le style jazz. Ce changement de rythme fonctionne comme une ouverture, et rend possible une forme d'égalité par la lenteur.
De la même manière, un peu de la gravité ou du sens attaché à chaque œuvre est délesté par ce simple glissement : rrrrrooooouuuuunnnddd, proposition chorégraphique de Mikaël Phelippeau reprenant une danse traditionnelle du Finistère, perd son caractère « folklorique » ; le boléro de Odile Duboc son aspect « pièce historique ». À voir les effets de dérive produits par la lenteur, on se prend à rêver d'une réunion de l'ONU au ralenti, d'un match de foot, au ralenti – de faire ses courses ou de manger au ralenti – afin de percevoir quelles zones inaperçues, quels réflexes invisibles sont activés, quels rapports de pouvoir, quelles doxa sont ainsi dévoilées.
Question subsidiaire : Le musée de la danse est-il un démusée de la danse ou un musée de la dédanse ?
Ralentir travaux
Quelle expérience avons-nous du ralenti ? Le cinéma, principalement, où il sert à exagérer une action, à pointer un détail, à décomposer un mouvement. C'est un effet spécial, emphatique ou pédagogique, un surplus de sens. Le ralenti proposé ce soir-là – appliqué à des œuvres n'ayant pas été conçues pour cette vitesse – ne montre pas mieux, il expose (le lieu, le public). Ce qu'il révèle concerne tout autant la chorégraphie elle-même que son mode d'apparaître, et son rapport à l'institution qui l'expose.
Contrairement à l'effet parfois épuisant des soirées accueillant une série de propositions chorégraphiques (qui cherchent plus le débordement vital, l'impression de chaos créatif que la mise en relation et la réflexivité) le pari du ralenti permet un vrai regard sur ce qui s'élabore. L'accumulation, l'effet de valeur lié à l'accumulation (on pourrait dire l'effet supermarché) est désamorcé. Le ralenti n'est plus un effet spécial, mais un véritable opérateur du regard, un prisme. Il opère un battement entre le concept de musée et celui de danse, il s'y glisse comme un entre-deux : soit les danseurs, en ralentissant, sont en train de se transformer en sculptures, en objets de musées. Soit ce sont des sculptures qui prennent vie, et rejoignent l'état vivant de la danse.
Plans
Étrange que d'entrer dans une salle, et de découvrir que les danseurs sont déjà en mouvement ; ils ne nous ont pas attendus. On prend la place qu'on peut, assis ou debout contre le mur, cherchant sa place à tâtons, marchant sur des pieds, bousculant des silhouettes invisibles. Derrière, au niveau d'une porte, un amas se constitue. D'autres personnes veulent entrer. Les danseurs, eux, suivent leur chorégraphie (il faut anticiper leurs déplacements, pour ne pas se trouver sur leur trajectoire).
Sensation tout d'abord malaisée, comparable à celle que l'on ressent en arrivant dans une salle de cinéma, alors que le film a déjà commencé. L'idée que ça a déjà débuté, et que ça continuera après (certains spectacles durant six heures, il est presque impossible de les suivre du début à la fin) crée un rapport non-linéaire à l'œuvre : on ne l'attrape plus par sa totalité, mais par fragments. Le résultat est plus proche de l'agrandissement d'une peinture que du ralenti cinématographique. Mais c'est le spectateur qui effectue la mise au point. Pour reprendre le titre du roman de Julien de Kerviler : « les perspectives changent à chaque pas ». Passer d'une pièce à une autre équivaut à effectuer un montage ou un cut-up. En se plaçant au seuil de deux espaces, on peut passer de l'une à l'autre (ou même les embrasser d'un même regard) ; varier les plans, s'approcher, ajuster la focale, tourner autour.
Peut-être qu'à une autre échelle, vu par un œil surplombant, le musée serait une sculpture, une œuvre en perpétuelle transformation ; des volumes qui s'épaississent ou se fluidifient. Et l'unique archive de ce musée, un dessin figurant l'ensemble des trajets effectués (« Rien n'aura eu lieu / Que le lieu / Excepté peut-être / Une constellation »).
Gilles Amalvi
lire
Etrangler le temps par Gilles Amalvi
Retour sur Préfiguration