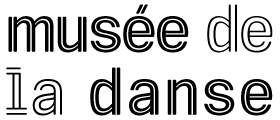Grimace du réel est une programmation qui réunit spectacles, projection de films, débats. De quelle manière ce projet s’inscrit pour vous au sein du Musée de la danse?
La première chose, c’est la possibilité offerte par le Musée de créer un temps à part : un temps qui permette de faire remonter l’archéologie d’un travail, de déplier ses enjeux, de ramener les sources, sources d’inspiration, de réflexion. Dans un cadre de diffusion «normal», il n’y pas forcément l’opportunité de le faire – même si un certain nombre de personnes qui présentent mon travail le font en général avec beaucoup de finesse. Le Musée de la danse permet de montrer les conditions d’émergence des œuvres ; de voir ce qui s’actualise, ce qui s’historicise... Après, le fait que Boris Charmatz nomme cette institution «musée» pose un certain nombre de questions intéressantes. Chaque projet accueilli invente une nouvelle fiction, qui s’inscrit, et déplace la fiction du musée. J’ai traversé le musée différemment lors de rebutoh, quand j’ai ré-interprété un extrait de la sorcière de Mary Wigman, dans une version étirée... Ce sont, à chaque fois, des couches hétérogènes qui sont dépliées, qui dé-hiérarchisent la notion d’icône muséale – que cela passe par la citation, l’actualisation ou par la création...
L’horreur comique – le premier titre évoqué pour cette programmation – renvoie à un cycle de films présenté à Beaubourg – qui dépliait le lien entre rire et cruauté. À quoi renvoie cette idée d’horreur comique dans votre propre travail?
Il y a le cycle et le livre : L’horreur comique, esthétique du slapstick. Les textes réunis dans l’ouvrage de Philippe-Alain Michaud ont été une source d’inspiration importante pour moi. J’y ai trouvé une proximité avec ce que j’essaie d’articuler sur scène, une proximité finalement plus grande que vis-à-vis d’autres œuvres chorégraphiques. La question du décryptage des registres de discours est assez peu présente dans l’espace chorégraphique. Il y a aussi une dimension de «critique sociale» qui me semble presque taboue. Pendant le cycle, j’ai revu certaines œuvres que je connaissais déjà, mais le fait qu’elles soient rassemblées et problématisées ensemble permettait de les lire autrement. J’aimerais que ce type de relecture des œuvres puisse se produire avec Grimace du réel.
Selon vous, comment une œuvre chorégraphique peut mobiliser ensemble les dimensions du corps, de la critique sociale – opérer leur montage et leur décryptage?
Je pense que c’est un lieu de pensée et de travail assez difficile à aborder. Sans doute que la forte influence de la danse américaine – le développement d’une culture abstraite – a eu un impact dans le champ chorégraphique. L’influence de Merce Cunningham en particulier – par qui j’ai été formée en partie d’ailleurs. Quand on observe certains aspects du travail de Valeska Gert, on est beaucoup plus proche de ces questions là. Aujourd’hui, la question de la figure reste peu explorée. C’est une notion qui m’importe énormément – la figure, la défiguration, la grimace. L’horreur comique le montre très bien : on a affaire à une part refoulée de la modernité. Par exemple, j’ai été assez étonnée de voir à quel point la nudité montrée dans Self Portrait camouflage pouvait être difficile à regarder ; pour certains spectateurs, elle était presque insupportable. Au-delà de la nudité elle-même, la figure qui s’expose nous confronte à un corps social et politique. Ce corps n’est pas facile à représenter, et il n’est pas facile à regarder. Il n’y avait pas de ma part de volonté provocatrice : j’envisage plutôt Self Portrait comme une partition. Si on l’analyse du point de vue du schéma corporel, ce sont des suites de tensions, dans une lenteur assez extrême. Mais tout tient à la manière de charger la figure, de la charger de signes, de la contextualiser, d’opérer un montage – montage qui ne se fond pas dans un récit linéaire, mais qui raconte autre chose que l’aspect purement physique du corps.
Avec cette notion de «figure», on touche à la fois à l’effroi, à la joie d’avoir un corps, et à la représentation de l’autre. Comment ces deux dimensions sont convoquées dans Grimace du réel?
L’important concernant la programmation, c’est je crois de rester à l’endroit de l’art : montrer des œuvres. En même temps, faire remonter l’archéologie des travaux, montrer leurs conditions d’émergence – quand ça a été fait, comment, produisant quel choc, quelle charge de réalité – c’est forcément être en prise directe avec le réel. Les rencontres avec le public permettront, je l’espère, de mettre en relation les différentes strates soulevées. Mais l’évènement de la rencontre n’est pas évident à former non plus. Pour qu’un échange intéressant émerge, il est important que s’établisse un va-et-vient entre ce qu’évoquent les œuvres pour chacun, ce qui nous touche – et les traductions, les passages qui s’opèrent vers une réflexion sur un état social.
Pour ce projet, vous avez invité le chorégraphe brésilien Luiz De Abreu. Est-ce que son travail apporte une autre perspective – un nouage particulier entre colonisation européenne, cultures indiennes, africaines?
Oui – mais je crois qu’aussi bien dans Self Portrait camouflage que dans O samba do crioulo doido, la question traitée est plutôt : comment la pensée est colonisée. Aujourd’hui, on est dans une période emblématique de cette colonisation de l’imaginaire – en France et de manière générale. Dans Self Portrait camouflage, la question coloniale est un symptôme, elle indique quelque chose de l’organisation interne de la pièce. Cette pièce est une fiction et une auto-fiction. La dimension historique entre en jeu, dans la manière dont ces fictions sont construites, mais la pièce ne cesse de déborder ce contexte. L’ouverture vers l’œuvre de Luiz amène une autre série de couches – qui touchent au fait d’être noir, homosexuel au Brésil, sans jamais s’y réduire. J’espère que les spectateurs pourront découvrir son œuvre sans se focaliser sur une dimension particulière.
J’ai l’impression qu’il y a là un paradoxe créatif. Par exemple, dans sa pièce I wanna be wanna be, Boyzie Cekwana commence par maquiller son visage de formes noires, puis le peint entièrement en noir, avant de le recouvrir de talc blanc – à la manière des acteurs blancs des «minstrel shows», qui se grimaient en noir. Un noir qui se peint en noir, qui se peint en blanc... On pourrait dire que ces œuvres cherchent à opérer la capture d’une image impossible, parce que déjà capturée par un imaginaire dominant...
Oui, je crois que c’est peut-être la fonction de la «figure» dont je parlais : être suffisamment plastique, insaisissable, pour réussir à «piéger cette image impossible»... Dans Self Portrait, j’ai essayé de faire en sorte que la figure construite ne soit jamais piégée à un endroit, qu’elle ne puisse être réduite à un point de ce qui la compose. Même si à un moment, très clairement, j’interpelle les politiques, je me fais le porte-voix d’une figure populaire, avec un accent du Maghreb – la figure n’est jamais absolument ce qu’elle prétend être. Dans la première partie, la moins décryptée, on se retrouve face à quelque chose d’étrange, d’étranger. Ensuite, c’est une figure hétérogène, dont on reconnaît certains signes, mais qui convoque plusieurs registres, de façon à avoir des modes d’impact différents sur l’imaginaire.
À travers la programmation proposée, qui comprend votre solo, Self Portrait camouflage, le film Flaming creatures, et le solo de Luiz De Abreu – une double dimension émerge, qui met en lumière la relation entre «politique du corps colonisé» et «politique du genre». Est-ce que ces deux dimensions vous paraissent indéfectiblement liées?
Oui, dans la mesure où ces questions se rejoignent sur le plan du minoritaire. Concernant le film de Jack Smith, au-delà de l’impact qu’il a eu sur moi – je crois que c’est la manière dont il défigure ce qu’il compose qui m’intéresse. Il y a les raisons formelles qui construisent une figure de l’horreur, et la manière dont ces figures travaillent la question du minoritaire. Je crois que c’est à l’œuvre dans chacun des projets.
Parmi les films que vous citez comme des sources importantes, il y a également Les maîtres fous de Jean Rouch. Pour reformuler la question autrement, de quelle manière des films comme Les maîtres fous et Flaming creatures nous disent quelque chose de ce corps minoritaire – d’un corps qui échappe aux conventions du regard social?
Je dirais que la force de ces œuvres tient dans leur potentiel d’émancipation – la manière dont elles s’imposent, s’affranchissent. A la différence de Flaming creatures, Les maîtres fous de Jean Rouch n’est pas une fiction, mais un documentaire. La question de l’émancipation y est centrale. Jean Rouch documente un rite directement en relation avec la situation coloniale – un rite qui renverse les codes de la puissance colonisatrice. Pour les films de Smith, c’est différent, la fiction produit un décollement du support, un décalage du regard. La façon dont sont montrés les corps est assumée avec une grande force, et re-situe le regard dans l’espace social. En ce sens, le film agit comme un virus, virus dont nous serions tous porteurs. De manière générale, m’intéressent les œuvres qui envisagent la subjectivation comme un fait complexe, à resituer sans cesse.
Le projet comprend un volet «parole publique». Comment sera-t-il mené, et quelle sera sa visibilité lors du week-end?
Nous sommes en train de travailler dessus. Au départ, il y a une idée très simple : le Garage est situé dans un quartier, et il faudrait que la frontière soit moins étanche entre ce lieu et les habitants qui l’entourent. J’ai donc proposé de rencontrer des associations qui travaillent dans ce quartier, tout en faisant très attention – parce qu’en tant qu’artiste, je ne suis pas un lieu, je ne suis pas dans une problématique de « relation avec le public ». Ma question serait plutôt : à qui ça s’adresse?
Est-ce que ces pièces, qui constituent des «actes de subjectivation», pourraient permettre des formes de subjectivation collectives?
C’est parti de cette idée, c’est le cœur de l’enjeu – mais je crois qu’il faut un peu le modérer. Est-ce que ce ne serait pas un autre projet, indépendant de cette programmation? Un projet sur le long terme, où l’on pourrait montrer des œuvres, en discuter, travailler à la table... Il faut faire attention à ne pas instrumentaliser le travail lui-même, et le public. Grimace du réel est différent d’un projet comme le Musée précaire de Thomas Hirschorn, qui est très clair dans ses objectifs – que l’on soit d’accord ou non avec ces objectifs d’ailleurs. Pour être un peu cynique, le risque, quand on mélange l’artistique, le pédagogique, les volontés politiques... c’est de rentrer dans des histoires de quota : un quota d’étranger, un quota de femmes, un quota d’handicapés... Sans compter que Self Portrait camouflage, Flaming creatures, ou O samba do crioulo doido ne sont pas exactement des œuvres faciles à aborder...
Lors de cette programmation auront lieu des conférences, des débats. Quels points de vue seront abordés?
L’idée c’est de partir des œuvres, d’opérer un décryptage, de faire remonter l’archéologie. Après, nous sommes en train de réfléchir aux intervenants. La question, c’est de savoir dans quel champ – plutôt esthétique ou historique? Si je fais venir un historien spécialiste des questions coloniales, cela risque de tirer la lecture de ce côté-là. Je ne voudrais pas que ce soit le filtre qui permette de tout interpréter. J’aimerais également que la programmation comprenne d’autres œuvres cinématographiques. J’ai demandé à Luiz De Abreu de m’indiquer des films ayant été une source dans sa recherche – afin de confronter des références différentes. Après, peut-être que seront montrés d’autres films de Jack Smith, dont l’œuvre est mal connue. Je pense aussi aux films de Jean Rouch, à Carnets de note pour une Orestie africaine de Pasolini, Tous les autres s’appellent Ali de Fassbinder, Intervention divine de Elia Suleiman... D’ailleurs, il y a un très bel entretien avec Elia Suleiman, où il parle du lien entre comique et horreur – la manière dont le comique opère pour lui comme une stratégie de survie.
Dans votre solo et celui de Luiz De Abreu, on retrouve l’idée de se vêtir du drapeau. À quoi correspond cet habillage pour vous? La première fois que j’ai vu le solo de Luiz, c’était dans le cadre d’une programmation au LiFE de Saint Nazaire. Christophe Wavelet m’avait parlé des enjeux du travail, mais pas de sa réalisation formelle. Du coup, quand j’ai vu l’usage qu’il faisait du drapeau, cela m’a étonnée et amusée. Dans le cas de Self Portrait, j’ai d’abord cherché des signes comportant un certain degré de cryptage. Le drapeau est très explicite, mais il recouvre différents niveaux de lecture, il se combine avec d’autres signes. Une fois que j’avais décidé que c’était un signe que je voulais utiliser, j’ai essayé de l’incorporer dans la fiction – je m’habille avec, et je vais jusqu’à l’ingurgiter... Une fois que j’avais pu lui donner des statuts différents, j’ai pu l’assumer comme un signe qui pouvait être piégé. Et puis les bandes tricolores ont été découpées dans la longueur... donc, selon la manière dont il est utilisé, il ne dit pas la même chose... A certains moments, ce n’est plus le drapeau français, mais le drapeau hollandais... Cela m’a même servi une fois à Beaubourg... Le régisseur technique m’a dit?: avec les nouvelles lois, on n’a pas le droit d’utiliser le drapeau, cela peut devenir un outrage aux symboles de la république. Et je lui ai dit?: mais ce n’est pas le drapeau français, c’est le drapeau hollandais?! Le fait d’utiliser ou non ces signes à «faible degré de cryptage» a vraiment été une question. C’est le cas également pour l’accent du Maghreb. Ce sont des signes qui peuvent assez vite nous piéger du côté du sens.
Finalement, chaque élément de la pièce peut-être lu du côté du «self-portrait », et du côté du «camouflage»...
Absolument. Chaque élément du montage dramaturgique joue sur cet équilibre. Une part de la dramaturgie est construite autour de la parole : discours muet, discours qui imite l’accent du Maghreb... mais le seul moment où l’on entend ma «vraie» voix, c’est lorsque je dis : « c’est bizarre, il y a toujours un moment où j’ai une petite parano...?». C’est la seule adresse frontale. Je crois que tout est une question de dosage.
Entretien réalisé par Gilles Amalvi - Rennes, le 8 janvier 2010